Covid 19 : point de vue d’un « administrativiste sanitaire » Par Didier Truchet
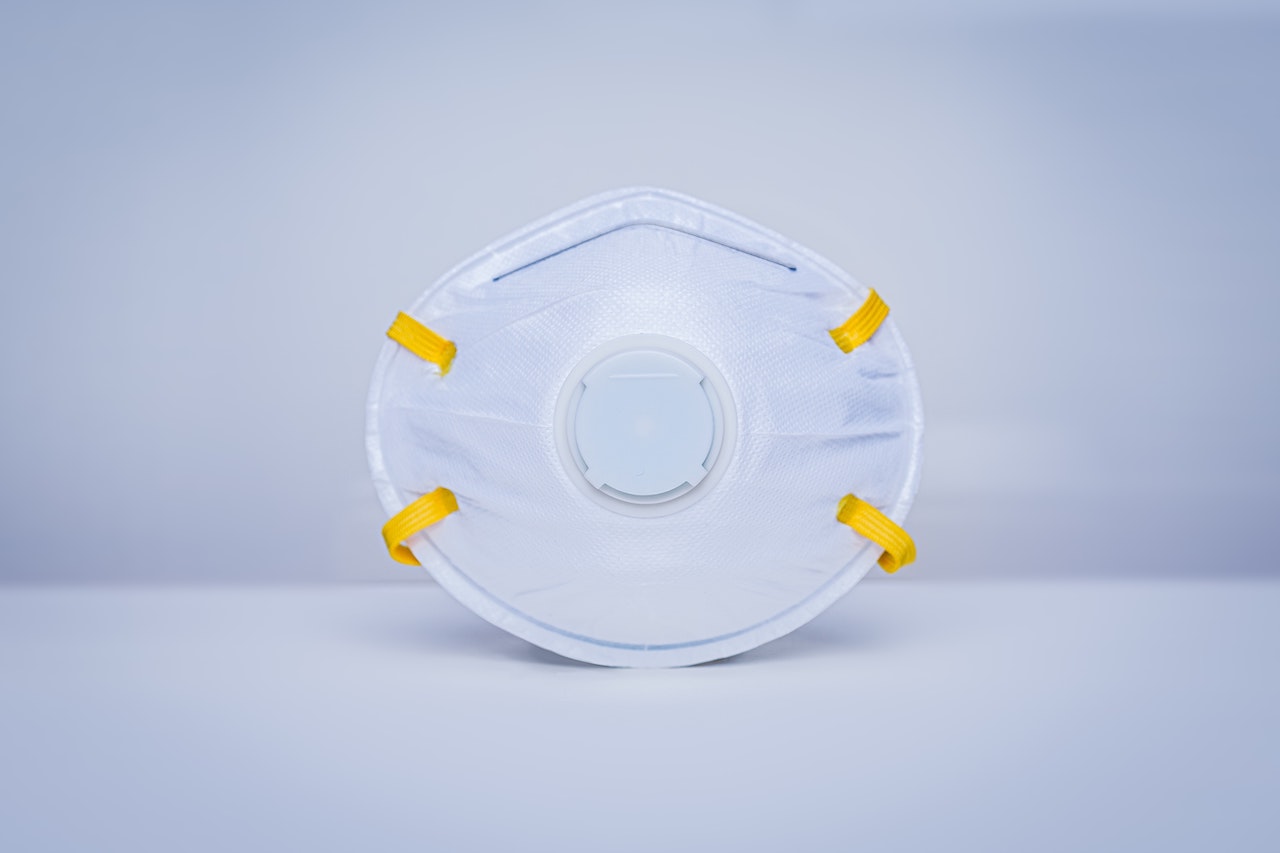
L’épidémie de covid19 est interprétée différemment par les diverses disciplines du droit public. Un spécialiste du droit administratif de la santé peut ainsi noter, à propos de cette affaire que, d’une part, elle traduit le vieux réflexe légaliste français (recourir à la loi pour régler le problème ad hoc) et que, d’autre part, elle révèle l’extraordinaire difficulté devant laquelle se trouvent placés les « décideurs » pour adapter au cas par cas, mesure après mesure, la réaction de l’Etat.
The Covid-19 epidemic is interpreted differently in the various branches of public law. An administrative health law specialist may note that this epidemic reflects the old French legalistic reflex (resorting to the law to settle the ad-hoc problem), but it also reveals the extraordinary difficulty faced by “decision-makers” to adapt the government’s response on a case-by-case basis.
Par Didier Truchet, Professeur émérite de l’Université Paris II Panthéon-Assas
Le professeur O. Beaud m’a demandé de contribuer à un blog normalement réservé à des spécialistes de droit constitutionnel et de science politique, alors que je ne maitrise que droit administratif et droit de la santé. Les circonstances exceptionnelles autorisant bien des dérogations à l’ordre normal des choses, j’en ai été flatté et ai accepté avec plaisir. Je suis néanmoins conscient du caractère un peu décalé des observations qui suivent, écrites trop vite pour être vraiment réfléchies.
I – A CHAQUE DISCIPLINE, SON APPROCHE
Ma première observation porte sur la différence entre l’approche de la crise suscitée par le covid 19 par mes amis constitutionnalistes et son approche par ma discipline.
En général, je suis surtout sensible à l’unité du droit public. Elle reste présente. D’abord, nous nous attachons tous à l’Etat et ce n’est pas rien : décrié en temps ordinaire, critiqué, voire considéré comme dépassé par les indépendantistes, les régionalistes, les décentralisateurs, les partisans d’une démocratie participative…, il redevient, comme toujours en temps de crise, celui dont on attend tout, immensément légitime pour protéger la population, quand bien même on lui reprocherait de mal s’acquitter de sa tâche. C’est vrai dans l’ordre intérieur. Mais il en va de même dans l’ordre externe[1]. Le virus ne s’arrête pas aux frontières, mais celles-ci se sont immédiatement refermées partout dans le monde, nonobstant la mondialisation, l’OMC (dont on ne parle plus !), l’UE, Schengen, etc. Quelles que soient les mesures d’information, de concertation et de coopération internationales[2], c’est bien dans un cadre strictement national que la situation est gérée. Ensuite, tous nous parlons de l’équilibre, de l’exercice, de l’extension et des limites des pouvoirs publics et de la conciliation entre contraintes et libertés, lors d’une crise aussi dramatique que celle que nous vivons.
Mais ce qui me frappe en ce moment, c’est surtout que chacun de nous se replie sur les « fondamentaux » de sa discipline, au point de presque l’autonomiser. J’admire le talent des constitutionnalistes pour controverser à propos de la sauvegarde et de l’aménagement des procédures et des compétences[3], de la place du Parlement et du Conseil constitutionnel ; j’admire tout autant leurs efforts pour protéger les droits politiques et constitutionnels contre une excessive dégradation liée aux circonstances. Mon admiration est absolument sincère, mais je ne peux m’empêcher de me demander : « mais est-ce vraiment le moment ? Est-ce vraiment le sujet alors qu’il faut surtout prendre les mesures nécessaires et simplifier le processus de décision ? ». Les administrativistes paraissent plus expéditifs ou plus réalistes. Non qu’ils ignorent ou minorent les exigences de l’Etat de droit en situation dégradée, mais parce qu’ils sont très sensibles à la nécessité de mettre l’Administration en capacité légale de parer au plus pressé : sans renoncer à la proportionnalité des mesures prises avec la gravité de la menace, ils sont sans doute prêts à admettre de très larges inflexions de la légalité, précisément pour rester dans le cadre de celle-ci. En somme, ils s’en tiennent à un célèbre passage des conclusions de Romieu devant le Tribunal des conflits, dans l’affaire Société immobilière de Saint-Just (2 décembre 1902)[4]. Je comprendrais très bien le possible étonnement des constitutionnalistes devant ce qu’ils pourraient prendre pour une forme de laxisme, un souci insuffisant des droits fondamentaux ou une tentation regrettable de sacrifier l’essentiel au conjoncturel, mais je ne peux pas parler à leur place.
J’ai eu tort de parler des « administrativistes » car je n’ai aucun titre à prétendre m’exprimer en leur nom, d’autant qu’ils ne sont sans doute pas unanimes. En outre, mon passé « sanitaire » fausse certainement ma perspective. J’ai été très marqué par mon passage au Conseil supérieur d’Hygiène publique de France[5], à l’époque du SRAS et de la grippe aviaire ; j’y siégeais, si je me rappelle bien, comme « membre invité permanent », statut inventé sans texte pour faire une place à un juriste. J’y ai vu l’impossibilité de prévoir le totalement imprévisible, l’immense difficulté de décider en situation d’incertitude scientifique à peu près totale, et combien les mesures à prendre étaient très concrètes, de détail, soumises à des modifications incessantes. La tentation de tout sacrifier à la lutte contre la pandémie et de perdre le sens des principes juridiques existait inévitablement[6] ; cependant l’idée que « même lors d’une crise grave, on ne doit pas tout sacrifier à l’intérêt de la santé publique[7]», prévalait en fin de compte. Mais mon expérience est ancienne et limitée, car le SRAS, le H1N1 ne s’étaient pas développés en France, contrairement, hélas, au covid 19. C’est d’ailleurs en quoi la situation actuelle est inédite et pourquoi les pouvoirs publics ne peuvent pas s’appuyer sur les enseignements d’une crise antérieure.
En tout cas, cela m’a rendu très indulgent envers le ministre de la santé, quel qu’il soit. Non seulement, sa tâche est immensément difficile, mais encore il joue toujours perdant devant la presse et l’opinion publique : ses échecs, ses hésitations, ses excès[8] sont très visibles et lui valent d’âpres critiques. En revanche, ses succès sont invisibles car personne (pas même, lui) ne peut savoir ce qui ce serait passé si il n’avait rien fait : on ne lui en sait donc pas gré. En réalité, c’est vrai de toute la police administrative (ou en tout cas, des polices de l’ordre public), mais cette asymétrie des perceptions est particulièrement forte en période de crise.
II- A CHAQUE CRISE, SA LEGISLATION SUR L’URGENCE
La bonne vieille jurisprudence sur les circonstances exceptionnelles[9] suffirait à fonder juridiquement les mesures prises pour lutter contre la pandémie actuelle. En pratique, elle ne fonctionne pas, en tout cas a priori. Elle n’a servi (très rarement) au juge que pour valider a posteriori les mesures attaquées devant lui.
Pourquoi ? Parce que, me semble-t-il, nous sommes vraiment un pays de droit écrit. L’attitude serait sans doute très différente dans un pays de common law, où la jurisprudence de Conseil d’Etat aurait valeur de précédent. Les administrations ne connaissent pas la théorie des circonstances exceptionnelles et lorsqu’on leur en parle, s’en méfient : elle n’est pas dans leur road book. Alors, on l’écrit, car quoi qu’on en dise, nous vivons dans un pays profondément légaliste et démocratique, attaché au « fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels », serait-ce dans des conditions de délibération inhabituelles.
On l’écrit dans la constitution (chacun aura reconnu l’article 16 dans la citation qui précède), et surtout dans la loi. On le fait toujours dans l’urgence, chaque crise suscitant sa législation ad hoc, avec son champ d’application propre, alors que la théorie des circonstances exceptionnelles est susceptible de s’appliquer à toutes les situations qui l’exigent. Au temps de la guerre d’Algérie, ce fut le cas de la loi du 3 avril 1955 sur l’état d’urgence. Les attentats de 2015 n’ont pas manqué de provoquer à plusieurs reprises son adaptation aux circonstances par le législateur. Puis une loi du 30 octobre 2017 a procédé à ce que l’on a nommé « l’inscription dans le droit commun » de certaines mesures prises quand l’état d’urgence était en vigueur, en principe jusqu’au 31 décembre 2020.
Les mêmes causes produisent les mêmes effets en matière sanitaire. Convaincue que les grandes pandémies appartenaient à un passé révolu, la France (elle n’était pas la seule) avait baissé sa garde juridique. Alors que l’époque mettait à juste titre, l’accent sur les droits du malade et la démocratie sanitaire[10], les mesures de contrainte paraissaient trop attentatoires aux libertés pour avoir leur place dans notre arsenal juridique. Le pays se trouva donc fort dépourvu lorsque le SRAS fut venu en 2003. On n’avait pas de fondement textuel sur lequel appuyer des mesures aussi brutales, sommaires et pourtant nécessaires, que, par exemple, un confinement d’une personne, a fortiori de la population. La canicule de 2003 a confirmé que notre sophistiqué système de santé, performant envers les affections connues, était mal armé (faute notamment d’informations remontant aux pouvoirs publics) face à un phénomène naturel (ce que sont aussi les pandémies) massif et sans précédent à ce niveau. La réaction est venue avec la loi du 5 mars 2007 relative à la « préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur ». Sa substance réside essentiellement[11] dans l’article L 3131-1, CSP : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population.
Le ministre peut habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d’application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces dernières mesures font immédiatement l’objet d’une information du procureur de la République ».
« Toute mesure …proportionnée et … appropriée » : on ne pouvait pas faire plus large, tout en s’inscrivant dans les principes du droit de la police administrative générale. C’est sur ce fondement légal que le ministre de la santé, seul compétent, a pris toutes les mesures de « lutte contre la propagation du virus covid 19 » qui se sont succédées quasi quotidiennement depuis son premier arrêté du 4 mars 2020. Mais voilà qu’à nouveau, le gouvernement a fait intervenir « à chaud » le législateur, avec la loi précitée du 23 mars 2020[12]. Son versant sanitaire était-il nécessaire ? Au fond, non : ce sont les mêmes mesures qui seront prises et elles auraient pu l’être aussi bien en vertu de la théorie des circonstances exceptionnelles qu’en application de la loi de 2007. Mais elle n’est pas inutile. Elle offre aux décisions du gouvernement la sécurité juridique que procure l’onction du législateur. Dans le champ sanitaire, son effet principal est de ré-agencer les compétences et les procédures administratives. L’article L 3131-1, CSP demeure, et avec lui, la compétence exclusive du ministre de la santé, en cas de « menaces sanitaires », nouvel intitulé du chapitre dans lequel l’article se trouve (avant la loi du 23 mars, c’était « mesures d’urgence »).
Mais la loi crée un nouvel « état d’urgence sanitaire » (nouveaux art. 3131-12, CSP). Il concerne non plus une « menace sanitaire grave » (ce qu’était le SRAS en 2003), mais une situation pire encore, une « catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population » (ce qu’est le covid 19 aujourd’hui). Lorsqu’il est déclaré par décret en conseil des ministres les mesures de police exigées par la situation, relèvent désormais du Premier ministre. Faudrait-il y voir, politiquement, une marque de défiance de M. E Philippe envers M. O Véran, le ministre de la Santé ? Je ne le crois pas du tout. Ou une nouvelle manifestation de la manie française d’adopter une loi, dès qu’un problème nouveau apparaît ? Je ne le crois pas davantage. Il s’agit en premier lieu de placer le niveau de décision là où il doit logiquement se trouver pour prendre des mesures qui concernent l’ensemble du gouvernement. Il était assez étrange de voir le ministre de la santé décider dans son arrêté du 14 mars (modifié le 17 et le 19) la suspension de l’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement, l’interdiction des escales de navires de croisière en France d’Outre-mer et en Corse, la suspension des concours de recrutement de fonctionnaires et de magistrats… Sans beaucoup de rigueur, c’est cependant la ministre de la transition écologique et solidaire qui a modifié « vu l’arrêté du 14 mars 2020 (précité), et les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de covid 19 », par exemple la réglementation des temps de conduite des chauffeurs routiers (arrêté du 20 mars). En second lieu, on peut imaginer (car ce n’est qu’une supposition) que ce retour à Matignon va soulager opportunément les services du ministère de la santé[13] de tâches qu’ils n’étaient pas outillés pour remplir et qui devaient faire perdre du temps en coordination interministérielle, alors que, sans doute, les bureaux sont vides, les agents confinés en télétravail et accablés par leur mission proprement sanitaire en pleine crise.
III – A CHAQUE EVOLUTION, SA MESURE
Il est impossible de présenter ici, même de manière résumée, les mesures qui se succèdent jour après jour, pour lutter contre le covid 19. Je n’ai pas l’intention (et de toute manière, pas les connaissances nécessaires) d’en apprécier la pertinence, l’efficacité ou les déficiences[14]. Et pas davantage pour jauger la qualité de la communication présidentielle ou gouvernementale[15]. Je souhaite seulement présenter deux observations.
La principale souligne la question essentielle de la connaissance. Il y a trois mois, personne au monde ne connaissait le virus responsable du covid 19. Aujourd’hui encore, malgré les efforts énormes et incroyablement rapides de la recherche mondiale (bravo à la réactivité des chercheurs !), on en sait peu sur lui, on n’a pas de thérapeutique sûre, pas de vaccin. Et pourtant, il faut bien aux pouvoirs publics, prendre des décisions qui sont autant de paris. Chacun mesure-t-il bien la difficulté de leur tâche ? Un souvenir m’a marqué : je me trouvais assis entre deux des meilleurs virologues français, au moment de la grippe aviaire : l’un me glissait dans l’oreille droite : « toute cette agitation est ridicule : il ne se passera rien en France, au pire une grippette (sic) », et l’autre dans l’oreille gauche : « ça va être une catastrophe épouvantable : on sous-estime complètement la gravité de la situation » ; je me disais « mon Dieu, si j’étais le ministre, que ferais-je face à la division des experts les plus pointus ? ».
La première ignorance est l’étendue de la maladie. Au niveau mondial, l’OMS est chargée en application du Règlement sanitaire international[16], de recevoir les notifications des Etats et de les transmettre aux 195 autres Etats membres. Encore faut-il que les Etats puissent et veulent le faire (apparemment, cela s’est amélioré depuis le SRAS) … Mais, pour autant que je sache, l’OMS ne contrôle pas véritablement ces notifications : elle les reçoit et les transmet. Elle émet en outre des recommandations, mais son rôle s’arrête là. Au niveau national, on voit bien que même des Etats aussi développés que la France, ne parviennent pas à connaître le nombre de porteurs du virus (notamment, les « porteurs sains »), celui des malades et celui des morts : seul celui des personnes diagnostiquées et des personnes décédées dans un établissement de santé paraît sûr, mais il ne traduit qu’une partie de la réalité. Or ces données seraient nécessaires pour affiner la stratégie. Mais les responsables politiques, administratifs et scientifiques les ignorent et doivent naviguer à vue.
Ils sont aidés par les experts. Leur omniprésence est une caractéristique de la crise actuelle, pas seulement dans les médias, mais aussi dans le processus de décision. Le président de la République (quoiqu’il soit juridiquement incompétent pour prendre les mesures, sauf désormais pour signer le décret déclarant l’état d’urgence sanitaire, qui est délibéré en conseil des ministres[17]) a créé discrètement, puis mis en scène un comité de scientifiques que les textes ne prévoyaient pas à l’époque. Sans doute, lui fallait-il compenser son impopularité politique par une légitimité scientifique, pour obtenir la confiance et l’adhésion des citoyens. Certes, la décision formelle reste une décision administrative prise par l’autorité compétente et soumise au contrôle du juge administratif : le premier ministre et le ministre de la santé insistent sur ce point, et c’est à leur honneur. Mais je ne puis les croire, tant j’ai pu constater que dans le domaine sanitaire, l’expert était en réalité le plus souvent, le véritable décideur sur le fond.
Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que les mesures prises changent constamment. Ma deuxième observation porte précisément sur leur cohérence. Beaucoup reprochent au gouvernement des contradictions : il y en a, c’est vrai, mais le plus souvent, il s’agit en réalité d’adaptations aux évolutions très volatiles de la situation épidémique et des connaissances scientifiques. Que l’on tâtonne, improvise, change d’avis, peut déconcerter ou inquiéter (l’auteur de ces lignes tout autant que quiconque), mais somme toute, est assez normal, et sans doute même, nécessaire.
Les critiques parlent d’incohérence : il aurait été incohérent de fermer les commerces non alimentaires et de maintenir le premier tour des élections municipales, incohérent de laisser ouverts les magasins d’alimentation et de fermer les marchés, etc. Mais par rapport à quelle cohérence ? Si l’on se place, comme le font très souvent les médecins (c’est leur mission !), au seul point de vue de la protection de la santé, alors oui, c’est sans doute incohérent. Comme il l’est de nous laisser sortir pour des courses (de nourriture ou à pieds) en période de confinement. Mais il y a une autre cohérence, que le droit de la police administrative a toujours poursuivie : elle consiste à mettre en balance l’intérêt de la santé publique et d’autres intérêts généraux ainsi que les libertés publiques. Cette exigence classique de nécessité, de proportionnalité et d’adaptation[18] impose des choix équilibrés. On peut les critiquer et les combattre, mais je ne vois là aucune incohérence.
CONCLUSION
Dans les circonstances actuelles, ne tirons donc pas trop sur l’Etat et ceux qui le font tourner ! On fera le bilan de leurs faiblesses (avant comme pendant la crise[19]) et de leurs mérites plus tard. Et ce n’est pas pour tout de suite : la fin du confinement ne signifiera pas retour à la normale. Il y faudra des mois… Et puis, reconnaissons à nos dirigeants de ne pas avoir nié la crise, comme ont pu le faire leurs homologues chinois (dans un premier temps), américains, anglais, brésiliens …
[1] Les observations des spécialistes de droit international public et de droit européen seraient très intéressantes sur ce point. Celles des spécialistes de droit financier public tout autant, d’ailleurs !
[2][2] Pour ce qui est de l’OMS, voir infra, III.
[3] Y compris mais pas seulement, l’article 16 (cf Sur ce blog, la dernière contribution du professeur O. Beaud).
[4] Sur une question procédurale d’exécution d’office, et non sur le fond du droit : évoquant « le cas d’extrême urgence, entendu dans le sens de péril imminent pour la sécurité, la salubrité et le bon ordre », Romieu disait que « tout le monde reconnaît qu’il est de l’essence même du rôle de l’administration d’agir immédiatement et d’employer la force publique sans délai ni procédure, lorsque l’intérêt immédiat de la conservation publique l’exige : quand la maison brûle, on ne va pas demander au juge l’autorisation d’y envoyer les pompiers. Sur ce point, il n’y a jamais eu de contestation ».
[5] Comme son nom très « Belle époque » le suggère, il avait été créé par la grande loi de santé publique du 15 février 1902. Il a été remplacé en 2004 par le Haut conseil de la santé publique (j’adorerais que soit créé un jour un « bas conseil » ou une « basse autorité » !). J’ignore pourquoi ce dernier est si peu évoqué dans la crise actuelle et semble évincé par le comité de scientifique constitué sans texte autour du Président de la République, et qui vient d’être en quelque sorte, ratifié par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid 19 (nouvel article L 3131-19, CSP).
[6] Surtout chez les experts scientifiques et médicaux (volontiers « jusqu’au boutistes », mais c’était leur rôle), et beaucoup moins à la Direction générale de la santé: sans vraiment le savoir, j’ai l’impression que c’est encore le cas aujourd’hui.
[7] C’est le titre retenu par Le Monde pour l’interview qu’il m’avait demandée (21 mars 2020, p. 21).
[8] Par exemple, la vaccination ordonnée par Mme Bachelot et qui était probablement inutile.
[9] CE, 28 juin 1918, Heyriès ; 28 février 1919, Dames Dol et Laurent.
[10] Cf la loi dite « Kouchner » du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
[11] Outre d’une part, l’institution d’une réserve sanitaire qui a été mobilisée assez souvent (sans que la Presse en ait parlé) et qui l’est massivement à l’heure actuelle, et d’autre part, un régime spécial d’indemnisation par la solidarité nationale.
[12] Non soumise au Conseil constitutionnel, mais dont on peut parier que certaines de ses dispositions feront un jour ou l’autre l’objet d’une QPC, même si la loi du 23 mars suspend les QPC.
[13] Qui reste compétent lorsque l’état d’urgence sanitaire est en vigueur, pour prescrire notamment « toute mesure réglementaire relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé » (nouvel article L 3131-16, CSP). Pourquoi d’ailleurs « dispositif » et pas « système de santé » qui aurait mieux convenu ?
[14] Il ne manque pas de gens pour s’en charger ! Comme le professeur Beaud, je trouve non seulement « déplacées », mais encore absurdes, les plaintes déposées ces jours ci contre les membres du gouvernement.
[15] Je dirai seulement que j’aime bien qu’une autorité ou un expert déclare « je ne sais pas », lorsqu’en effet, on ne sait pas, parce que les connaissances n’existent pas.
[16] Le RSI actuel a été adopté en 2005 (il tire notamment les conséquences du SRAS). Publié en France par le décret n° 2007-1073 du 4 juillet 2007, il a dans notre ordre juridique l’autorité que l’article 55 de la Constitution attache aux traités et accords internationaux régulièrement ratifiés et approuvés.
[17] Et les ordonnances : vingt-huit au JO du 26 mars 2020 ! Le Parlement s’est mis sur la touche, mais le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels n’est manifestement pas interrompu.
[18] Que rappelle le dernier alinéa du nouvel article L 3131-15, CSP.
[19] Notamment à propos de la question des masques : on s’apercevra sans doute que la criante insuffisante de leur nombre est le fruit d’une gestion routinière des stocks depuis dix ans, à un niveau relativement subalterne de l’Administration, sans qu’aucun ministre ait eu de décision à prendre. Ce qui n’est pas une excuse !
Credit photo: Vincent Ghilione, CC 2.0
