Oiseaux. Quelques remarques sur la trahison des mots et des normes Par Ariane Vidal-Naquet
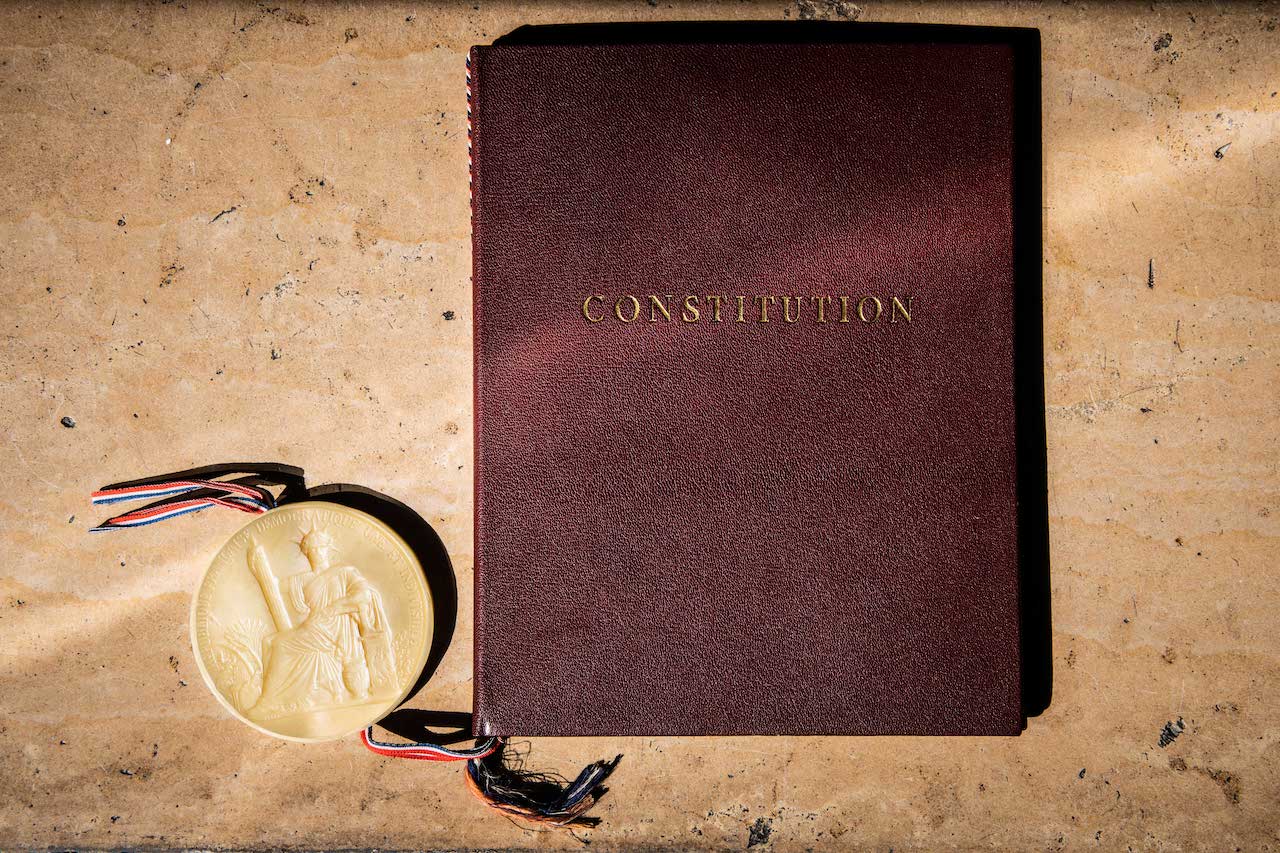
Oiseaux… ou le plus traitre mot de la langue française dont on ne prononce aucun son des lettres qui le composent… ou petit clin d’œil pour réagir au récent billet publié par Armel Le Divellec dans ce blog, intitulé Anticonstitutionnellement. Courtes remarques sur le mésusage du mot le plus long. Dans ce billet, Armel Le Divellec réagit à un court article de presse généraliste, au format réduit, paru dans Le Monde le 10 janvier 2024 et portant sur les pratiques anticonstitutionnelles. La présente réponse entend prolonger la discussion.
Passé sur les critiques assez sévères portant sur le caractère approximatif de mon propos et la mise en cause de sa pertinence voire de sa crédibilité scientifique, passé encore sur la technique argumentative assez classique consistant à présenter le propos comme minoritaire pour mieux se rehausser[1], le billet d’Armel Le Divellec soutient que le terme « anticonstitutionnellement » ne doit être « employé qu’avec circonspection, à bon escient, dans des situations où il se justifie vraiment » et entend expliquer pourquoi l’accusation de « pratiques anticonstitutionnelles » n’aurait pas dû être proférée.
A l’appui de sa démonstration, Armel Le Divellec mobilise de nombreux contre-exemples, recourt à plusieurs arguments d’autorité en se référant à de grands noms de la doctrine constitutionnaliste (tout particulièrement Capitant, Carré de Malberg) et propose sa lecture des articles 8 ainsi que des articles 5 et 20 de la Constitution, découpage qui structure son article. Le désaccord porte, ainsi qu’il l’énonce en fin d’introduction, « sur le sens du mot Constitution ou, plus encore, sur la normativité constitutionnelle et, plus largement encore, sur le droit ».
En réalité, et contrairement à ce que le ton de l’article pourrait laisser entendre, la mésentente ne relève ni d’une querelle liée à des questions de personnes, ni d’une opposition dogmatique qui porterait sur le contenu substantiel des dispositions constitutionnelles, mais d’un désaccord théorique qui porte sur la notion de Constitution et qui rétroagit, inévitablement, sur l’usage du terme « anticonstitutionnellement ». Plus encore, et cela mérite d’être dit afin d’éclairer totalement le lecteur, le désaccord porte, en réalité, sur le cadre théorique d’analyse du droit et, en conséquence, d’analyse du droit constitutionnel. Armel Le Divellec inscrit son discours dans le cadre du droit constitutionnel comme droit politique ; le mien conçoit le droit constitutionnel à partir du normativisme[2]. Autrement dit, le désaccord révèle deux visions du droit.
L’objet du présent billet n’est pas de disqualifier le discours d’Armel Le Divellec mais d’en éprouver la solidité. Il ne s’agit pas de contester le cadre d’analyse qu’il retient (et qui n’est ni vrai, ni faux, ni bon, ni mauvais) mais de le mettre à l’épreuve. Cela suppose non seulement de le re-construire – voire de le construire tant les tenants du droit politique sont finalement peu explicites sur ce qu’ils appellent « droit politique » – mais aussi d’en tester la cohérence interne. Autrement dit, que veut dire Armel Le Divellec et le dit-il de manière cohérente ? Quatre points de son discours méritent d’être successivement éprouvés : quelle conception de la Constitution, quelle conception des normes constitutionnelles, quelle conception de l’interprétation de la Constitution et, enfin, quelle conception de l’irrégularité constitutionnelle.
Quelle conception de la Constitution ?
Après avoir indiqué, en fin de son introduction, que le désaccord porte sur le « sens du mot Constitution », Armel Le Divellec ne définit pourtant ni ce qu’il entend par Constitution, ni ce qu’il entend par normativité constitutionnelle, ce qui aurait pourtant été utile pour éclairer le débat.
S’agissant de la notion de Constitution, Armel Le Divellec souligne qu’une partie de la doctrine définit la Constitution comme une collection de normes juridiques, approche dont il semble se départir, soulignant qu’il s’agit là d’une « conception et un usage que l’on peut trouver étroits mais qui sont très largement partagés par les juristes contemporains ». Cette affirmation est, en réalité, fausse d’un point de vue empirique au regard du discours de la doctrine constitutionnaliste[3]. Surtout, il est curieux qu’il n’ait pas aussitôt, et dans la mesure où il explique que le désaccord porte sur le sens du mot Constitution, profité de son billet pour préciser ce qu’il entendait, pour sa part, par Constitution. Il faut donc faire ici un effort de construction, à partir de son discours : pour Armel Le Divellec, il existe bien des normes juridiques mais « Encore faut-il s’entendre où est le droit, et quelles sont les normes juridiques qu’il convient de respecter ». Plus loin, il concède qu’il existe ces « fameuses normes juridiques » mais qu’il faut s’entendre sur leur « prétendue « normativité », c’est-à-dire sur « leur caractère d’obligation proprement juridique, plus exactement sur la portée de cette obligation ». Ce propos semble assimiler la normativité à la juridicité – et inversement – tout en expliquant que toutes les normes n’ont pas forcément le même degré de normativité et qu’il faut donc déterminer, pour chaque norme, « le sens de l’obligation posée par la norme juridique » ou encore leur « implication juridique ». Si l’on peut tout à fait concevoir qu’il existe des énoncés, notamment constitutionnels, qui ne posent pas des normes juridiques, la suite de son propos ne permet pas de déterminer ce qui permet d’identifier la normativité. Elle ne permet pas non plus d’identifier la portée de l’obligation juridique qui résulte des dispositions constitutionnelles. L’on comprend que, pour Armel Le Divellec, les dispositions constitutionnelles peuvent être lues sur un mode « mineur » ou « majeur » [4] sans que l’on sache à quoi correspondent ces deux modes de lecture, ni comment choisir entre eux.
L’on comprend encore que le texte constitutionnel contiendrait des clauses purement « littéraires » et des clauses « techniques », sans qu’il n’explique comment il convient d’entendre, de manière générale, chacune de ces catégories de clauses. Seraient ainsi des énoncés purement littéraires celui contenu dans l’article 5 de la Constitution ainsi que, au détour d’une note de bas de page, le principe de fraternité. Ces dispositions littéraires sont définies par Armel Le Divellec comme celles qui « ne fixent pas en elles-mêmes et à elles seules une attribution qui pourrait être d’emblée traduisible en termes de technique juridique, en particulier l’accomplissement d’actes juridiques formalisés définis ab initio. On ne saurait même pas valablement les qualifier de dispositions « habilitatrices » comme peuvent l’être, mais selon un mode technique, par exemple l’article 12 C, relatif au droit présidentiel de dissolution et le second alinéa de l’article 21 C qui désigne le Premier ministre comme étant titulaire du pouvoir réglementaire ». Ainsi, pour Armel Le Divellec, « La charge normative des articles 5 et 20, al. 1er C, c’est-à-dire ce qu’ils imposent juridiquement, n’est pas de même nature que celle des dispositions du texte constitutionnel qui confèrent des attributions précises à travers des actes formalisés ». Autrement dit, si l’on suit l’auteur, les clauses littéraires sont toutes celles qui ne fixent pas une habilitation, ce qui ravale, par déduction, toutes les normes qui obligent ou interdisent parmi les normes littéraires : les libertés, par exemple, qui sont des permissions d’agir seraient des normes littéraires à la portée normative douteuse. Surtout, le raisonnement proposé par Armel Le Divellec obscurcit la question de répartition des compétences entre les autorités normatives posée par les articles 5 et 20. Ces derniers désignent les autorités habilitées, respectivement, à assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et à déterminer et conduire la politique de la Nation. On ne voit pas ce qui, dans ces habilitations, serait de charge normative moindre. D’autant que la suite du texte constitutionnel permet de préciser comment s’exercent ces compétences, notamment à travers « l’accomplissement d’actes juridiques formalisés ».
La fin de l’article révèle, plus nettement, la conception qu’a l’auteur de la normativité constitutionnelle : le droit constitutionnel, assimilé à la Constitution, ne dispose que d’une normativité relative : « l’une des particularités du droit constitutionnel, même justement lorsqu’il est apparemment « formalisé » au plus haut niveau dans un document appelé constitution (formelle), consiste non seulement en son caractère fragmentaire (il ne prétend pas « tout régler » à la manière d’un code) mais surtout en son caractère de cadre (rahmenartig) : la raison tient à ce que certaines activités se dérobent à une normation trop détaillée et rigide ». Si à l’évidence, la Constitution ne peut pas tout prévoir, elle entend, précisément, fixer les modalités de production des autres normes, soit générales et abstraites, soit individuelles et concrètes, et désigner les titulaires d’une habilitation à produire des normes de concrétisation, comme le font, par exemple, les articles 5 et 20 C. Soutenir que la Constitution ne peut pas tout prévoir ne permet pas de lui dénier, pour autant, le caractère de norme ou même de la doter d’une normativité relative.
Quelle conception des normes constitutionnelles ?
Après avoir abordé la « prétendue normativité » des normes constitutionnelles, Armel Le Divellec entend détailler « quelles sont les normes juridiques qu’il convient de respecter », notamment s’agissant de celles déductibles des énoncés des articles 8, 5 et 20 de la Constitution. Autrement dit, partant d’une analyse des énoncés constitutionnels, il entend préciser quelles obligations juridiques peuvent en être déduites. Son propos renseigne, en creux, sur la façon dont il situe la norme juridique par rapport aux énoncés textuels.
S’étonnant de ce que « les juristes aiment faire parler les mots inscrits dans les textes », Armel Le Divellec manifeste, en premier lieu, une forte défiance à l’égard des énoncés textuels. De fait, il propose à l’appui de son argumentation une analyse qui s’éloigne fortement des énoncés textuels. Revenant sur l’article 8 § 1, qui précise que le Premier ministre présente la démission du Gouvernement, l’argumentation d’Armel Le Divellec s’attarde sur les motifs qui peuvent pousser le Premier ministre à la démission, au demeurant fort bien imaginés, y compris le coiffeur. Mais le silence de la Constitution sur les raisons de la démission n’est nullement en cause. Ce que l’article paru dans Le Monde dénonce est un comportement des acteurs politiques – ici celui du Président de la République et non pas du Premier ministre – qui est contraire à la lettre de la Constitution, par exemple lorsque le Président exige la démission du Premier ministre, ce que suggèrent les termes de la lettre de démission adressée par Elisabeth Borne, voire lui demande de signer une lettre de démission en blanc au moment de son entrée en fonction. De de ce point de vue, il est inutile de rappeler, comme le fait Armel Le Divellec, que « ce fut le cas pour la plupart de ses prédécesseurs, en cours de législature, depuis Michel Debré en 1962 », la pratique ne permettant nullement de régulariser des irrégularités constitutionnelles. Quant à l’argument selon lequel « Seul l’article 50 de la Constitution lui fait obligation de la présenter lorsque l’Assemblée nationale a adopté une motion de censure ou a refusé d’approuver le programme ou la déclaration de politique générale du gouvernement », il fragilise, en réalité, la cohérence de son raisonnement : l’article 50 pose une obligation de démission, l’article 8 § 1 une permission. Le Premier ministre peut démissionner s’il le souhaite et non pas parce que le Président le veut, précisément parce que le Premier ministre n’est responsable que devant le Parlement et non pas devant le Président.
Revenons encore sur l’article 8, alinéa 2 de la Constitution, dont l’énoncé textuel n’est, curieusement, pas rappelé par Armel Le Divellec : « sur la proposition du Premier ministre », le Président de la République « nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions »… Sans vouloir faire parler les textes plus que de raison, ces termes peuvent sembler assez clairs. Ils pourraient même, pour reprendre le raisonnement d’Armel Le Divellec, se traduire par un acte formel du Premier ministre proposant les membres de son Gouvernement au Président de la République. Surtout, la comparaison opérée par Armel Le Divellec avec d’autres pays infirme, en réalité, sa démonstration. Il explique en effet que, dans certains pays, et à l’inverse de la France, le Président de la République ne peut pas empêcher le Premier ministre de constituer son équipe citant l’Italie en exemple. Or, l’article 92 de la Constitution italienne affirme, en des termes quasi identiques à ceux de l’article 8, alinéa 1 de la Constitution française, que « Le Président de la République nomme le Président du Conseil des ministres et, sur proposition de celui-ci, les ministres »[5]. Dans le cas de l’Italie, Armel Le Divellec déduit de l’article 92 que le Premier ministre doit être libre, sauf exception, de constituer son équipe alors que, dans le cas de la France, la même conclusion serait tout à fait « intenable juridiquement », ce qui souligne la fragilité de son analyse des énoncés textuels ou, plus exactement, des normes juridiques qu’il déduit des énoncés textuels.
Quelle conception de l’interprétation ?
Le désaccord est encore le résultat d’une divergence théorique sur les méthodes d’interprétation qui peuvent être utilisées pour dégager le sens d’un énoncé textuel et identifier, en conséquence, les normes juridiques qui en découlent. A reconstruire la position d’Armel Le Divellec, l’on retiendra qu’il exclut la méthode littérale d’interprétation pour lui préférer – quand cela lui semble opportun – une méthode d’interprétation systémique.
Excluant la méthode littérale, Armel Le Divellec considère que les mots n’ont pas toujours un sens et si, parfois, ils en ont un, il convient de ne pas le retenir. C’est ce qu’illustre son analyse des articles 5 et 20 de la Constitution. Il commence par souligner que « ces deux dispositions paraissent indiquer une répartition approximative des tâches respectives du Président et du Gouvernement », ce qui est assez curieux à la lecture desdits articles : « le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation » ; le Président de la République « assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat ». Il affirme ensuite, de manière assez contradictoire, puisqu’il vient de soutenir que les énoncés des articles 5 et 20 étaient approximatifs, que la rédaction de l’article 20 « paraît exclure clairement le chef de l’Etat de la détermination de la politique. A ce titre, il pourrait gêner l’analyse ». Mais, de façon très acrobatique, il explique alors, qu’en dépit du sens évident de l’article 20, « cette interprétation ne doit pas être retenue parce qu’elle serait presque tautologique ». Pour Armel Le Divellec, un Gouvernement a évidemment pour mission de déterminer et de conduire la politique de la Nation – il emprunte donc ici la position dite essentialiste qu’il a dénoncée juste avant – de sorte qu’il est inutile de le rappeler. Autrement dit, et la démonstration est ici très audacieuse, il faut admettre que l’article 20 a un sens mais qu’il ne faut pas retenir ce sens car ce serait affirmer deux fois le sens de ce qui est naturellement… Bref, que sens sur sens ne vaut !
Toute aussi acrobatique est son analyse de l’article 5 de la Constitution et, notamment, le sens du mot « arbitre », qui ne voudrait rien dire au motif qu’il « ne renvoie à aucun concept juridique déterminable ». L’affirmation est doublement curieuse car non seulement la Constitution n’utilise pas – et heureusement – que des concepts proprement « juridiques », employant des mots courants (hommes, femmes, langues par exemple) mais encore, la Constitution n’a pas vocation à poser des « concepts juridiques ». Elle en use mais ne les construit pas. C’est à la doctrine qu’il revient d’établir des concepts juridiques : et de ce point de vue, il est étonnant qu’il faille renoncer à donner un sens au mot arbitre tel qu’il figure dans la Constitution au motif qu’il ne renvoie à aucun concept juridique déterminable… Si l’on considère, au contraire, que les mots ont un sens, y compris les mots constitutionnels c’est-à-dire ceux qui sont utilisés dans le texte constitutionnel (et non pas ceux qui seraient propres à la Constitution), l’on pourra considérer, et tel était l’objet de la tribune parue dans Le Monde, qu’un arbitre ne peut pas, sauf à trahir les mots, être dans la mêlée et marquer un essai.
Après avoir écarté la méthode littérale, Armel Le Divellec prône le recours à une méthode systémique d’interprétation des textes constitutionnels. La position est assenée à plusieurs reprises : s’agissant des articles 5 et 20 de la Constitution, « leur implication juridique doit être à tout le moins interrogée, à la fois en eux-mêmes et dans une perspective systémique, la seule qui convienne » ; il reprend à son compte, ici, les propos de Capitant selon lequel « aucune constitution n’a jamais pu, ni ne pourra, dans l’avenir, être valablement interprétée par une autre méthode ». Le recours à cet argument d’autorité surprend, tant les liens entre Capitant et De Gaulle sont connus, le premier étant devenu l’un des principaux défenseurs de la Constitution de la Ve République et surtout, un fervent défenseur de la pratique gaullienne des institutions[6]. S’appuyant sur les écrits de Capitant, Armel Le Divellec se trouve alors placé dans une situation contradictoire. Il récuse l’interprétation dite génétique, c’est-à-dire celle qui se fonde sur l’intention des auteurs de l’acte, au motif que l’on ne peut jamais la connaître. Dans le même temps, il reprend les propos de Capitant selon lesquels « c’est le texte et non l’intention qui fait la loi », alors même qu’il vient d’expliquer qu’il fallait se méfier des textes[7]. Puis il suggère de recourir à une méthode d’interprétation systémique et d’éclairer le sens des articles 5 et 20 par l’article 19 C. Mais la démonstration est imparfaitement convaincante : la reconnaissance de compétences propres au profit du Président de la République, c’est-à-dire dispensées du contreseing ministériel, ne lui confère nullement une compétence pour déterminer et conduire la politique de la Nation à la place du Premier ministre. Au contraire, les compétences propres posées par l’article 19 C renvoient, pour l’essentiel, à la mission du Président visée par l’article 5 et confirment qu’il doit se cantonner à ces compétences. Plus encore, ce qu’Armel Le Divellec fait prévaloir dans l’ensemble de son billet n’est pas une méthode d’interprétation systémique mais plutôt une méthode que l’on pourrait qualifier de « légitimiste », interprétant les dispositions de la Constitution à la lumière de sa pratique par les acteurs politiques, conduisant ainsi, tout au moins indirectement, à les légitimer.
Quelle conception des irrégularités constitutionnelles ?
Le désaccord doctrinal porte encore sur la façon de concevoir les irrégularités constitutionnelles et notamment sur la possibilité d’apprécier un écart entre les normes juridiques et les comportements des acteurs politiques. Contrairement à ce qu’indique Armel Le Divellec, autre façon d’ailleurs de fragiliser son contradicteur en lui imputant un certain nombre de choix inconscients[8], c’est tout-à-fait volontairement que le terme de « violation » de la Constitution a été écarté au profit du terme plus neutre d’irrégularité juridique. Mais l’irrégularité constitutionnelle peut parfaitement être qualifiée, si le terme semble préférable, de « violation de la Constitution ».
Cette impossibilité d’apprécier l’écart qui sépare les normes juridiques des comportements des acteurs politiques est ainsi justifiée par Armel Le Divellec, s’agissant des rapports entre Président de la République et Premier ministre : « Entre ces deux institutions existe un espace juridiquement ouvert, dans lequel la répartition des rôles n’obéit pas à la simple logique binaire habituelle du droit entre le « légal » et l’ « illégal » (ici : constitutionnel/anticonstitutionnel) », invoquant d’ailleurs à l’appui de sa réflexion les propos peu convaincants de G. Conac[9]. Ce faisant, il se prive de toute possibilité d’apprécier la régularité juridique de la pratique des acteurs politiques. Puisque ce n’est pas le texte qui compte mais le texte interprété à la lumière de sa pratique, il n’est pas possible de mesurer la conformité de la seconde au premier. C’est ce qu’il admet, d’ailleurs, en fin d’article « La critique légitime des pratiques institutionnelles doit se faire sur un terrain politique, le cas échéant en proposant d’autres formules, mais non sous le couvert d’une argumentation touchant à la licéité juridique ». Autrement dit, la critique des pratiques ne peut pas se faire sur le terrain du droit, condamnant le juriste à l’impuissance. Il aurait d’ailleurs été intéressant qu’Armel Le Divellec explique ce qu’il entend par critique politique, une critique qui serait « pure » et totalement déliée des normes juridiques.
Cela ne l’empêche pas, pourtant, d’admettre qu’il existe, dans certains cas, des doutes sur la régularité de tel ou tel comportement. Dans ces hypothèses, le terme d’anticonstitutionnellement pourrait alors être brandi « à bon escient ». Mais comment peut-on déterminer une irrégularité « à bon escient » ? Selon Armel Le Divellec, « On peut, par exemple, légitimement émettre des doutes sur la régularité de l’interprétation du premier alinéa de l’article 49, bien qu’elle ait été validée par les acteurs, ou bien sur l’usage de l’article 11 pour réviser la Constitution, ou encore quelques autres. Mais ces points, pour importants qu’ils soient, ne sont pas décisifs en ce qui concerne le présidentialisme »[10]. Il aurait été utile qu’il explique pourquoi, dans ces deux hypothèses, il considère qu’il y a des doutes sur la régularité et donc, sauf à jouer sur les mots, des possibilités d’irrégularités constitutionnelles ou encore qu’il explique comment des irrégularités peuvent être « validées » par les acteurs. D’autant que cette concession finale le place dans une position schizophrénique. S’il appliquait ici son propre raisonnement, à savoir des dispositions indéterminées qui doivent être interprétées selon une perspective systémique, l’on pourrait soutenir que, puisqu’il appartient au Président de déterminer et de conduire la politique de la Nation, il est tout à fait contradictoire d’exiger du Gouvernement qu’il engage sa responsabilité sur son programme puisqu’il n’a, précisément pas, de programme, celui-ci étant déterminé par le Président de la République. Quant au recours à l’article 11 de la Constitution, et pour reprendre l’analyse de Capitant, qu’Armel Le Divellec a largement utilisé à l’appui de son raisonnement, celui-ci soutient que le recours à l’article 11 est parfaitement justifié parce que, lu en relation avec l’article 3 C, il n’est que l’illustration de la souveraineté du pouvoir constituant[11]. La cohérence de la démonstration voudrait donc qu’il n’y ait, dans une perspective systémique et en raison de l’indétermination des énoncés, aucun doute sur la régularité du recours au référendum pour réviser la Constitution.
Derrière l’ensemble de ces questions se profilent, en réalité, deux visions différentes du droit constitutionnel. Dans l’approche défendue par Armel Le Divellec, le droit constitutionnel n’est, en réalité, que le résultat de la pratique des acteurs politiques. Les normes constitutionnelles sont largement indéterminées ; les énoncés textuels ne peuvent faire l’objet d’une interprétation littérale ; leur sens ne peut être compris que dans une perspective systémique qui dépend, en réalité, moins de l’agencement des dispositions constitutionnelles que de la pratique qui en est faite ou de valeurs supérieures à l’aune desquelles il conviendrait de les interpréter ; la normativité de la Constitution est faible voire inexistante ; les pratiques des acteurs permettent de « valider » les normes constitutionnelles ou, en sens inverse, de les modifier ; les pratiques ne sont que rarement voire jamais inconstitutionnelles. Dans l’approche que j’ai souhaité défendre, le droit constitutionnel est un ensemble de normes juridiques qui résultent de la signification d’énoncés textuels ; ces énoncés peuvent faire l’objet d’une interprétation littérale par l’ensemble des acteurs qui ont vocation à les appliquer ; il est donc possible d’apprécier la régularité juridique des comportements des acteurs politiques ; il est, en conséquence, possible de dénoncer des irrégularités constitutionnelles.
Par Ariane Vidal-Naquet, Professeur de droit public à l’Université Aix-Marseille
[1] « Bien qu’elle soit, depuis longtemps, très répandue à la fois chez les commentateurs, dans une partie du personnel politique et même parmi de nombreux juristes (y compris fort éminents), une telle analyse ne nous paraît pas recevable »
[2] Qui a déjà donné lieu à une précédente controverse : voir A. Le Divellec, X. Magnon, A. Vidal-Naquet, Les Cahiers Portalis, n° 6, 2019/1, p. 89-128 (en ligne sur cairn.info).
[3] Voir S. Sydoryk, La doctrine constitutionnelle. Étude des discours de connaissance du droit constitutionnel contemporain français, PUTC, 2023
[4] Selon Armel Le Divellec, « Et on peut, sans doute, envisager de manière différente ces deux articles (ou partie d’article) : sur un mode « mineur » ou sur un mode « majeur ».
[5] Art. 92 « Le Gouvernement de la République est composé du Président du Conseil et des ministres qui constituent ensemble le Conseil des ministres. Le Président de la République nomme le Président du Conseil des ministres et, sur proposition de celui-ci, les ministres ».
[6] En ce sens, voir J.-M. Denquin, L’interprétation de la Constitution de la Ve République par René Capitant, préc. Jus Politicum,
[7] La position d’Armel Le Divellec devient alors intenable car une interprétation littérale de l’article 20 C exclut que le Président de la République détermine et conduise la politique de la Nation puisque cette compétence est attribuée au Premier ministre
[8] « Peut-être est-ce parce qu’elle sent inconsciemment sa propre position fragile qu’Ariane Vidal-Naquet n’a pas employé le terme de « violation » (d’une règle) »
[9] Selon Gérard Conac, cité par Armel Le Divellec : « Ce cumul [d’un président de la République à la fois chef de l’Etat et responsable suprême effectif de la politique de la Nation], dû aux rapports de forces, était constitutionnel, non pas parce qu’il était prévu expressément par la Constitution, mais parce qu’il n’était pas interdit par elle, donc constitutionnellement possible ». La justification parait, là encore, assez acrobatique car la lettre de l’article 20 selon laquelle le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation interdit que le Président puisse être « responsable suprême effectif de la politique de la Nation » d’autant que, précisément, il est irresponsable juridiquement, sauf exception.
[10] L’affirmation selon laquelle cette question ne concerne pas le présidentialisme peut surprendre, dans la mesure où, précisément, la pratique de l’article 49 C et de l’article 11 est le résultat d’une lecture présidentialiste de la Constitution, à savoir une lecture fondée sur la logique politique qui caractère le système de gouvernement de la Ve République.
[11] En ce sens, voir J.-M. Denquin, L’interprétation de la Constitution de la Ve République par René Capitant, préc. Jus Politicum
