L’éphémère suspension de TikTok aux États-Unis, un conflit entre sécurité nationale et liberté d’expression Par Marie Sissoko-Noblot
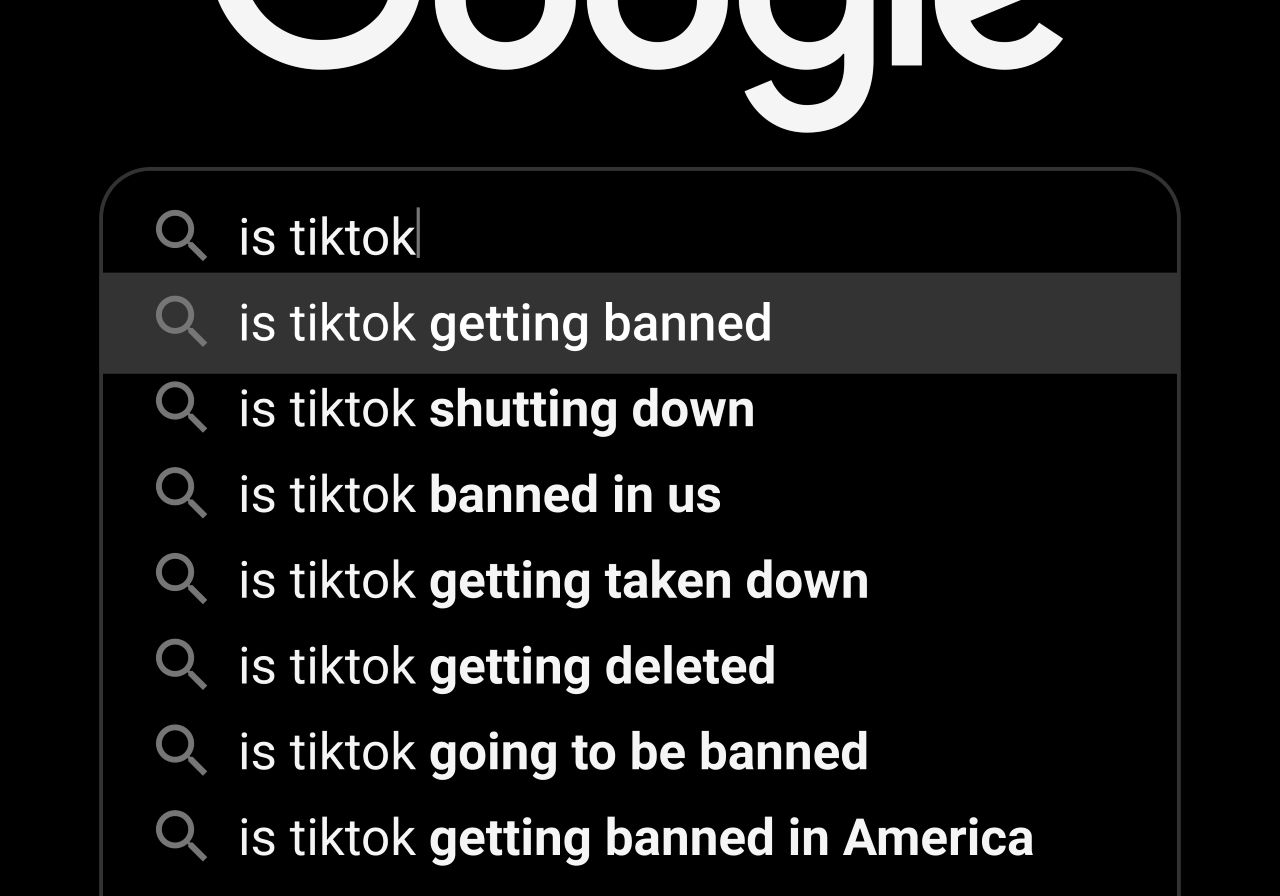
Le 17 janvier 2025, la Cour Suprême des États-Unis a validé la constitutionnalité du Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, interdisant TikTok aux États-Unis, sauf si l’entreprise est soustraite au contrôle chinois. La Cour a estimé que cette interdiction ne violait pas le Premier Amendement, malgré son impact sur la liberté d’expression. Elle a jugé que la mesure était justifiée par la sécurité nationale. Cette décision établit un précédent se voulant circonscrit sur les restrictions gouvernementales visant des plateformes numériques pour des raisons de sécurité nationale.
On January 17, 2025, the U.S. Supreme Court upheld the constitutionality of the Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, which banned TikTok in the United States unless the company is separated from Chinese control. The Court found that this ban did not violate the First Amendment, despite its impact on freedom of speech. Applying intermediate scrutiny, it ruled that the measure was justified by national security concerns. This decision sets a precedent for government restrictions on digital platforms for national security reasons.
Par Marie Sissoko-Noblot, Doctorante en droit public à l’Université Paris-Panthéon Assas
Le 17 janvier 2025, la Cour suprême des États-Unis a jugé que l’interdiction de TikTok, prévue par le Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, ne violait pas le Premier Amendement de la Constitution américaine. La loi visait à rendre illégales, à compter du 19 janvier 2025, les prestations de services liées à la fourniture, la distribution, l’entretien, ou la mise à jour de la plateforme TikTok par des entreprises américaines, à moins que l’exploitation américaine de TikTok ne soit soustraite au contrôle du gouvernement chinois. Aux États-Unis, TikTok est exploité par l’entreprise américaine TikTok Inc., dont la société mère, ByteDance Ltd., est une société privée chinoise propriétaire de l’algorithme de la plateforme. ByteDance est soumise à des lois chinoises qui lui imposent d’« aider ou coopérer » avec les activités de renseignement du gouvernement chinois, tout en garantissant à ce dernier un accès potentiel aux données privées détenues par la société. Cette situation a suscité l’inquiétude des autorités américaines ce qui justifiait l’interdiction conditionnelle de TikTok. Un groupe d’utilisateurs de la plateforme, ByteDance et TikTok avaient déposé une demande d’injonction temporaire auprès de la Cour suprême le 16 décembre 2024. Celle-ci avait accepté d’examiner l’affaire en urgence et établi un calendrier accéléré afin de statuer avant l’entrée en vigueur de l’interdiction. La lecture de la décision TikTok Inc. v. Garland laisse à son commentateur l’image d’un certain malaise de la Cour Suprême, tenue par de courts délais et soucieuse de ne pas établir de précédent. La solution de l’arrêt devant, selon elle, être « étroitement circonscrite à la lumière des circonstances » (Opinion de la Cour, p.2). La Cour décide de soumettre les restrictions posées par la loi au prisme du contrôle du Premier Amendement sans être toutefois pleinement convaincante au regard de sa motivation (I). Elle soumet les dispositions à un contrôle intermédiaire et admet que les restrictions sont justifiées en d’un risque pour la sécurité nationale (II).
I. L’interdiction du contrôle d’une plateforme numérique par un adversaire étranger : itinéraire d’un étrange « discours »
A. L’initiative de Donald Trump : contrôle et suspension de TikTok
Le 19 janvier, à la suite de la décision de la Cour, la plateforme a été suspendue et n’était plus accessible aux États-Unis. Dans la foulée, Donald Trump a promis qu’il suspendrait l’interdiction, ce qu’il fit en signant un executive order dès le 20 janvier, jour de son investiture, permettant à la plateforme de fonctionner pour une période de 75 jours. Il est ironique que Donald Trump, avant même son investiture, ait annoncé par décret la suspension d’une loi votée sous la présidence de son prédécesseur, alors que c’est lui-même qui avait initié sans succès le mouvement de contrôle de TikTok durant son mandat. En effet, comme le rappelle l’opinion de la Cour Suprême, « le président Trump a émis un décret exécutif constatant que « la diffusion aux Etats-Unis d’applications mobiles développées et détenues par des entreprises en Chine continue de menacer la sécurité nationale, la politique étrangère et l’économie des Etats-Unis » (Executive Order number 13942, 3 CFR 412 (2021), Opinion de la Cour, p.3). S’appuyant sur l’autorité conférée par l’International Emergency Economic Powers Act et le National Emergencies Act, le président avait tenté d’interdire certaines « transactions » impliquant la société chinoise propriétaire de TikTok ou ses filiales. Adoptée en 1977, la loi fédérale américaine autorise le président à prendre des mesures de régulation du commerce en réponse à une situation d’urgence nationale liée à une menace étrangère. Cependant, les tribunaux de district de Washington et du District Est de Pennsylvanie avaient censuré ces interdictions, estimant qu’elles outrepassaient les compétences conférées au pouvoir exécutif par l’International Emergency Economic Powers Act.1 De plus, le président avait ordonné à l’entreprise chinoise ByteDance de céder tous ses intérêts et droits de propriété « utilisés pour permettre ou soutenir l’exploitation de l’application TikTok par ByteDance aux Etats-Unis », ainsi que « toutes les données obtenues ou dérivées des utilisateurs américains de TikTok » (Opinion de la cour, p.3). La constitutionnalité de cet executive order2 avait été contestée, et la cour saisie avait sursis à statuer pour permettre au président Biden, nouvellement élu, de négocier une solution. L’objectif était de trouver une résolution au litige qui n’impliquerait pas une cession des droits de l’entreprise chinoise tout en répondant aux préoccupations liées à la sécurité nationale (TikTok Inc. v. Committee on Foreign Investment, No. 20–1444 (CADC, Feb. 19, 2021). Face à l’échec de ces négociations, le Congrès a adopté Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, soumis au contrôle de la Cour Suprême dans l’arrêt commenté. Deux constats peuvent être tirés de cette décision présidentielle. Sur le plan de l’opportunité politique, Donald Trump semble tirer profit du fait que la loi a été adoptée sous la présidence Biden. En annulant son effet par un executive order, il se présente comme un ardent défenseur de la liberté d’expression et des plateformes numériques. Cependant, cette décision est discutable au regard de l’opportunité juridique, car elle fragilise nécessairement la légitimité de la solution retenue par la Cour suprême.
B. La difficulté de la Cour Suprême à soumettre la loi contestée au contrôle du Premier Amendement
L’arrêt TikTok Inc. v. Garland constitue un étrange précédent en ce qui concerne l’interprétation du Premier amendement de la Constitution, qui stipule : « Le Congrès ne fera aucune loi […] qui restreigne la liberté d’expression ». En effet, la Cour procède à une motivation insatisfaisante quant au point de savoir si les motifs invoqués pour justifier l’application des dispositions contestées relèvent du champ d’application du Premier Amendement. Les requérants soulevaient que la suppression de l’application utilisée par des millions d’Américains pour communiquer, ainsi que l’obligation imposée à ByteDance de céder l’application sous 270 jours, constituaient une violation de la liberté d’expression. Le Premier Amendement s’applique aux discours considérés comme une « activité expressive protégée, ou conduite comportant une composante expressive », ainsi que les « des activités sans composante expressive [qui] imposent une charge disproportionnée à ceux qui se livrent à des activités protégées par le Premier Amendement » (Opinion de la Cour, p.7). Il s’agissait donc pour la Cour de déterminer si la loi restreignait de telles activités. La Cour procède à une analyse en deux parties, qui combine le sujet des restrictions (ByteDance) et les personnes affectées par celles-ci (les utilisateurs de la plateforme). Par conséquent, la Cour a admis qu’« une interdiction effective sur une plateforme de médias sociaux comptant 170 millions d’utilisateurs aux Etats-Unis entrave certainement l’activité expressive de ces utilisateurs d’une manière non négligeable » (Opinion de la Cour, p.8). Cette conclusion n’est pas surprenante, car la Cour avait récemment mis en avant l’importance des réseaux sociaux comme des forums publics modernes d’expression3. En revanche, la Cour ne reconnaît pas que l’activité de ByteDance est couverte par le Premier Amendement. En effet, la loi a interdit le contrôle de la plateforme par un adversaire étranger, ce qui, à première vue, ne constitue pas une conduite expressive. Toutefois, la Cour a rappelé que les entreprises qui gèrent des plateformes et modèrent leur contenu accomplissent des activités expressives couvertes par le Premier amendement4. Malgré cela, ByteDance ne bénéficie pas de cette protection, conformément à une jurisprudence de 2020 qui a établi que les organisations étrangères opérant à l’étranger ne jouissent d’aucun droit garanti par le Premier Amendement5. Dès lors, comme « l’activité expressive revendiquée par ByteDance Ltd. se déroule à l’étranger, cette activité n’est pas protégée par le Premier Amendement » (Opinion de la Cour, p.8). La Cour est donc contrainte de mobiliser sa jurisprudence sur la constitutionnalité des lois visant des activités sans composante expressive, mais qui imposent une charge disproportionnée à ceux exerçant des activités protégées par le Premier Amendement6 pour justifier de soumettre cet étrange discours au prisme du contrôle du Premier Amendement. La Cour souligne certes avec prudence, qu’« une loi visant le contrôle d’un adversaire étranger sur une plateforme de communication est, à bien des égards, différente des réglementations sur les activités non expressives que nous avons soumises à l’examen du Premier Amendement » et que sa jurisprudence antérieure n’a pas défini de cadre clair sur ce point (Opinion de la Cour, p.8). Elle n’en tire cependant pas la conclusion qui selon nous s’imposait, selon laquelle une réglementation d’une activité non expressive qui pèse de manière disproportionnée sur les personnes engagées dans une activité expressive n’est pas protégée par le Premier Amendement. Face à ce vide jurisprudentiel, les neuf juges ont décidé de ne pas « avoir besoin » de se prononcer immédiatement sur la question. Ils tranchent dans une formule étonnante : « Nous supposons, sans toutefois décider de manière définitive, que les dispositions contestées relèvent de cette catégorie et sont soumises à un examen approfondi au titre du Premier Amendement » (Opinion de la cour, p.9).
II. Le contrôle de la loi au prisme du contrôle « intermédiaire »
A. Le choix contestable du standard juridique applicable par la Cour suprême
En vertu de la jurisprudence de la Cour sur les limites à la liberté d’expression, les restrictions portant sur le contenu du discours (content-based) sont présumées inconstitutionnelles et ne peuvent être justifiées que si le gouvernement démontre qu’elles sont étroitement conçues pour servir des intérêts étatiques impérieux. Ces restrictions sont donc soumises à un contrôle strict (strict scrutiny). Pour passer le contrôle de strict scrutiny, une loi doit être étroitement adaptée à la promotion de l’intérêt étatique impérieux, tout en utilisant les moyens les moins restrictifs possibles pour l’atteindre7. De plus, une loi neutre sur le plan du contenu peut également être soumise à un contrôle strict si elle est motivée par une justification fondée sur le contenu du message8. En revanche, les restrictions neutres sur le plan du contenu (content-neutral) sont soumises à un contrôle intermédiaire (intermediate scrutiny). Elles ne seront pas censurées par la Cour si elles favorisent des intérêts gouvernementaux importants sans rapport avec la suppression de la liberté d’expression et ne restreignent pas cette liberté de manière substantiellement plus importante que nécessaire pour promouvoir ces intérêts9. Dans son arrêt, la Cour retient que « appliquées aux requérants, les dispositions contestées sont neutres sur le plan du contenu (facially content neutral) et justifiées par des raisons neutres (justified by a content neutral rationale) » (Opinion de la Cour, p.10). La Cour souligne que les restrictions sont neutres au regard du contenu dans la mesure où elles imposent à TikTok des interdictions liées au contrôle exercé par un adversaire étranger sur la plateforme, et que la cession de TikTok constitue une condition préalable à la poursuite de ses opérations aux Etats-Unis. Ainsi, la loi ne vise pas un discours particulier en fonction de son contenu (Opinion de la Cour, p.10) et repose sur une justification neutre, car elle est motivée par la vulnérabilité particulière de TikTok à un contrôle potentiel du gouvernement chinois (Opinion de la Cour, p. 11). L’objectif étant, selon la Cour, considéré comme neutre au regard du contenu, elle décide donc d’appliquer le niveau intermédiaire de contrôle (intermediate scrutiny). Or, les dispositions contestées nous paraissent bien fondées sur le contenu du discours. D’une part, seule l’entreprise TikTok est visée par la loi alors que l’ensemble des plateformes numériques pratiquent la collecte des données de leurs utilisateurs. D’autre part, le gouvernement avait invoqué devant la cour inférieure que la loi était notamment justifiée par le risque de promotion de contenus liés à la relation entre Taïwan et la Chine, lesquels pourraient être manipulés dans le cadre d’opérations d’influence par cette dernière. La Cour aurait donc pu soumettre les dispositions législatives au prisme du contrôle strict, ce qui n’aurait probablement pas permis de conclure à la constitutionnalité de la loi.
B. L’admission de la justification floue de la sécurité nationale
La Cour retient que les dispositions contestées « favorisent un intérêt gouvernemental important sans rapport avec la suppression de la liberté d’expression » et n’entravent pas la liberté d’expression de manière substantiellement plus importante que nécessaire pour favoriser cet intérêt10 (Opinion de la Cour, p.13). Elles satisfont donc le standard de contrôle intermédiaire conformément à sa jurisprudence Turner II. La Cour estime que ces dispositions favorisent indéniablement un intérêt gouvernemental important. L’argument invoqué par le gouvernement, à savoir la sécurité nationale et le risque d’ingérence par une puissance étrangère, répond donc à ce critère. La décision de la Cour est critiquable au regard du caractère spéculatif de ce risque. La jurisprudence antérieure exigeait que le gouvernement « assume une lourde charge » pour justifier des restrictions à la liberté d’expression au nom de la sécurité nationale11, ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce. Il convient de noter que les arguments des requérants étaient sur ce point peu convaincants et maladroits. Ils affirmaient notamment qu’il est « peu probable que la Chine oblige TikTok à transmettre les données des utilisateurs à des fins de collecte de renseignements, car la Chine dispose de moyens plus efficaces et efficients pour obtenir des informations pertinentes » (Opinion de la cour, p. 14). Néanmoins, ils avaient ainsi mis en avant que le fait que cette restriction repose sur une simple probabilité d’utilisation des données par le gouvernement chinois. Toutefois, la Cour justifie sa position de manière contestable en faisant preuve de « déférence substantielle aux jugements prédictifs du Congrès » (Opinion de la cour, p.13). Contrairement au contrôle strict, le contrôle intermédiaire n’exige pas que la régulation soit « le moyen le moins restrictif […] pour promouvoir les intérêts du Gouvernement »12. Selon les juges, les dispositions contestées, en imposant une interdiction conditionnelle visant à empêcher la collecte de données, ne sont pas « substantiellement plus large[s] que ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de sécurité nationale » (Opinion de la Cour, p.16). Les requérants avaient néanmoins proposé des mesures alternatives, comme des restrictions sur le partage de données. Ces alternatives n’ont pas été retenues par la Cour, qui a souligné qu’elles méconnaîtraient la latitude accordée au gouvernement pour mettre en œuvre des restrictions justifiées par des motifs neutres (Opinion de la cour, p.17). Ainsi, les dispositions contestées ne sauraient être jugées inconstitutionnelles au seul motif que l’objectif de sécurité nationale aurait pu être atteint par un moyen alternatif moins restrictif à l’égard de la liberté d’expression.
En somme, la Cour dans TikTok Inc. v. Garland, malgré la retenue dont elle fait preuve dans ses formulations, nous semble poser un précédent préoccupant au regard de la justification retenue pour motiver des restrictions de la liberté d’expression. Le Gouvernement ne se privera pas, selon nous, d’avancer à l’avenir l’argument de la sécurité nationale sans démonstration poussée pour restreindre des discours. Si la Cour avait refusé de juger l’affaire en raison des délais serrés, cela aurait pu être préférable à la légèreté de sa motivation à plusieurs reprises dans l’arrêt.
1 TikTok Inc. v. Trump, 507 F. Supp. 3d 92 (DC 2020) ; Marland v. Trump, 498 F. Supp. 3d 624 (ED Pa. 2020).
2 Les executive orders sont des actes du président de la République énonçant « unilatéralement des prescriptions générales et impersonnelles qui se rapprochent matériellement de la loi et qui s’appliqueront sur l’ensemble du territoire des Etats-Unis en dehors de tout processus législatif », S. Benzina, “Les executive orders du président des Etats-Unis comme outil alternatif de législatif », Jus Politicum, numéro 21, juillet 2018.
3 Packingham v. North Carolina, 582 U.S. 98 (2017).
4 Moody v. NetChoice, 603 U.S. 707 (2024).
5 Agency for Int’l Development v. Alliance for Open Society Int’l Inc., 591 U. S (2020).
6 Arcara v. Cloud Books, Inc., 478 U. S. 697 (1986).
7 McCullen v. Coakley, 573 U.S. 464 (2014).
8 Reed v. Town of Gilbert, 576 U. S. 155 (2015).
9 Turner Broadcasting System, Inc. v. FCC, 512 U. S. 622 (1994), (Turner I).
10 Turner Broadcasting System, Inc. v. FCC, 520 U. S. 180 (1997) (Turner II).
11 New York Times Co. v. United States, 403 U.S. 713 (1971) (per curiam).
12 Turner Broadcasting System, Inc. v. FCC, 512 U. S. 622 (1994), (Turner I).
